Dès sa plus tendre enfance, Robert Louis Stevenson eut une santé fragile : bronchites, pneumonies et autres maladies pulmonaires faillirent plus d’une fois l’emporter.
À l’entame des années 1880, alors qu’il était sur le point d’entrer dans la trentaine, il épousa à San Francisco Fanny Van de Grift, de dix ans son aînée, dont il était fou amoureux et qui venait enfin de divorcer de son chercheur d’or de mari Samuel Osbourne.
De retour en Écosse, il bénéficia des largesses paternelles pour survivre. Cela faisait plusieurs années que Stevenson se consacrait à l’écriture, ce qui se traduisait essentiellement en essais, journaux de voyage et récits de fiction plutôt courts, mais cela ne suffisait pas pour nourrir son homme, car le succès de ses rares publications s’avérait plus que modeste.
Nul roman ne trônait en tête d’affiche de sa production littéraire. Une surprise ? Assurément ! Quand il était enfant, Robert Louis Stevenson adorait se divertir avec des événements imaginaires et, depuis son entrée dans l’âge adulte, il avait tenté à une douzaine de reprises de s’échiner sur son idéal, un roman, mais ce genre littéraire se refusait toujours à lui. « C’est la longueur qui tue », avoua-t-il a posteriori. Passer des semaines sur un ouvrage unique était bon pour un écrivain accompli, dont le succès était garanti, mais pour quelqu’un qui ne perçait pas et avait besoin de rentrées, ça s’apparentait à un suicide économique.
Qui eût pensé que son retour en Écosse lui permettrait de réaliser ce rêve ?
Le fait que son père subvînt à nouveau à ses besoins financiers fut sans doute capital, mais pas déterminant car, d’après l’écrivain écossais, « le débutant doit avoir un souffle », « il doit être dans une de ces heures où les mots viennent et les phrases se balancent d’elles-mêmes ».
Ce fut en réalité un concours de circonstances qui le mena à son premier roman.
L’été 1881 était particulièrement maussade en Écosse ; la pluie ne cessait de tomber et l’humidité ambiante avait des répercussions négatives sur la santé de Stevenson. Son médecin le contraignit à se confiner entre les quatre murs du cottage où il séjournait. Les journées étaient longues pour tout le monde. Le fils de Fanny, Samuel Lloyd Osbourne, douze ans à peine, tuait le temps en peignant dans une pièce qu’il avait transformée en atelier. Robert Louis Stevenson lui rendait visite quotidiennement et, à l’occasion, s’installait lui aussi devant un chevalet.
Un jour, il peignit la carte d’une île dont la forme le fascina. Elle figurait une sorte de lourd dragon dressé et offrait des baies bien abritées ; son terrain escarpé se couvrait de forêts et un îlot — très vite baptisé Îlot du Squelette — lui faisait face.
Il étiqueta la toile L’Île au Trésor et, la contemplant, l’explorant d’un regard perçant, il entrevit tout ce qui pouvait s’y passer, il se laissa tout à coup pénétrer par un flot d’idées : un trésor caché, des pirates désireux de s’en rendre maîtres, une expédition en bateau, des poursuites, des batailles. N’y tenant plus, il s’empara des quelques papiers à portée de main et commença à rédiger le plan d’un roman qui allait faire sa renommée, un roman qui allait prendre le titre de cette carte, un roman qu’il allait dédier au petit Samuel Lloyd Osbourne.
L’histoire coulait en lui comme le sang ; chaque nouveau jour voyait naître un chapitre. L’écrivain écossais, qui en connaissait très peu dans le domaine de la marine, puisait toujours plus profond dans l’imaginaire qu’il avait développé depuis l’enfance. Il eut l’honneur de reconnaître ses sources d’inspiration : le perroquet de John Long Silver était sans doute celui de Robinson Crusoé, mais ce furent surtout les Contes d’un voyageur de Washington Irving qui insufflèrent l’esprit du livre et une quantité de détails matériels des premiers chapitres. « Je crois que le plagiat fut rarement poussé plus loin », affirma Stevenson avec modestie, alors que, sur le moment, son travail lui semblait pourtant « original comme le péché ».
Il n’y a sans doute rien de contradictoire dans la chose, dans la mesure où bien souvent l’esprit humain tend à reproduire ce dont il s’est nourri.













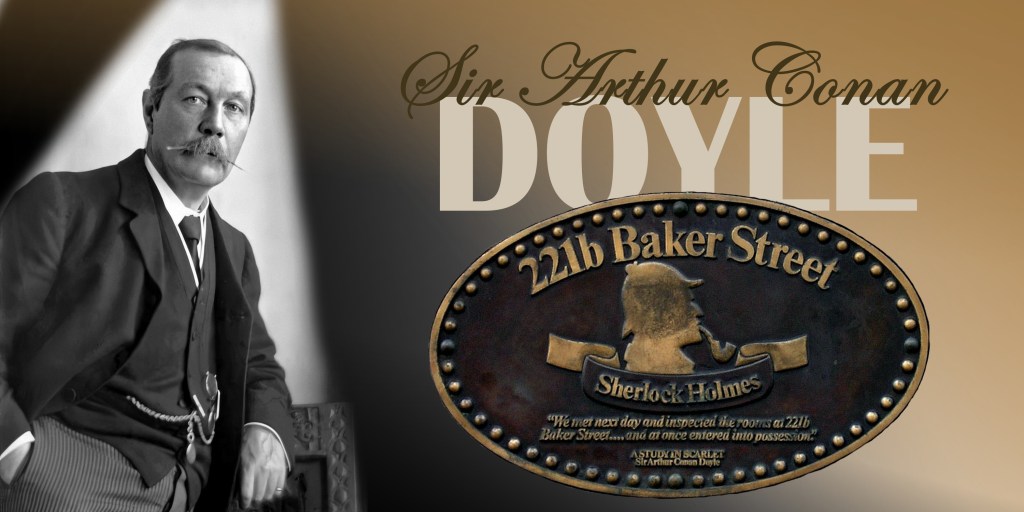





Laisser un commentaire