Bangkok, troisième jour : une journée laissée libre par l’agence dans notre programme. L’humidité rendait l’air suffocant. On avait annoncé de la pluie à partir de dix heures, le ciel était chargé, mais aucune goutte ne tombait.
Nous avions déjà vu suffisamment de temples et de palais. Nous voulions quelque chose de différent. Nous souhaitions marcher. Or, nous étions gavés de l’incroyable trafic qui régnait dans la capitale thaïlandaise.
Cette cité de onze millions d’habitants n’était pas faite pour les piétons. Traverser les rues et les carrefours se révélait un véritable danger, même aux passages cloutés. Il fallait guetter un trou dans le flot incessant d’automobiles et s’élancer au pas de course, en regardant des deux côtés à la fois, car le sens inversé de la circulation nous faisait constamment oublier de quel côté de la chaussée était susceptible de surgir un véhicule.
Tout favorisait les voitures. Tout. Ma théorie du moment, à moitié ironique et à moitié farfelue, était que la Thaïlande, pays sans doute plus structuré hiérarchiquement que nos sociétés occidentales, considérait les piétons comme des êtres inférieurs, car incapables de s’offrir un deux ou quatre roues, et qu’ils ne méritaient donc pas qu’on dépense un bath pour eux dans des infrastructures qui assurent leur sécurité. Les trottoirs étaient incertains, exigus, parfois inexistants, toujours frôlés par des automobiles, empuantis par les gaz d’échappement.
À chaque sémaphore, au moindre embouteillage, nous voyions comme les motos se faufilaient et dépassaient les voitures à l’arrêt, pétaradantes, nerveuses, zigzagantes. Jamais je n’aurais voulu rouler dans cette jungle. Ma plus grosse surprise, en termes de trafic automobile, fut de découvrir que certains feux rouges duraient de trois à cinq minutes, une éternité. Les conducteurs semblaient s’en accommoder. Il faut dire que leurs voitures étaient bien plus modernes et récentes que celles que l’on peut observer dans n’importe quelle capitale européenne. Un guide nous avait raconté que le Thaïlandais moyen changeait de voiture tous les sept ans environ, ce qui s’expliquait par leur prix modique, 15 000 euros approximativement, un prix rendu avantageux par la présence d’usines Toyota dans le pays.
Ce matin-là, nous avions repéré sur la carte, à l’est de l’hôtel, deux endroits de verdure — une rareté à Bangkok. Et nous étions bien décidés, qu’il pleuve ou que le soleil frappe, à nous y promener.
Dans le parc Lumpini, nous partîmes en quête de petits autels. Tout à coup, ma compagne m’indiqua quelque chose à deux mètres et je fis presque un bond. Un animal à la peau écailleuse, que sur l’instant je pris presque pour un crocodile dépourvu de gueule, se tenait figé au sortir des fougères qui bordaient le petit ru. Il mesurait un bon mètre et nous fixait de l’œil.
Nous nous souvînmes du panneau que nous avions lu quelques instants plus tôt : il fallait faire attention aux varans.
L’animal se mit à traverser le chemin de terre en direction du lac voisin. Deux jeunes touristes japonaises cherchèrent à caresser l’animal, qui siffla en signe de protestation et fit demi-tour, agacé. Peu à peu nous prîmes conscience qu’il n’était pas seul. De plus gros et de plus petits varans se reposaient un peu partout à proximité de l’eau.

Nous traversâmes le parc en diagonale et aboutîmes à une passerelle piétonnière surélevée qui reliait le parc Lumpini au parc forestier Benchakitti.

Longeant des quartiers pauvres et ouvrant la vue sur les innombrables gratte-ciel de Bangkok, elle semblait nous introduire dans un autre monde tant le bruit s’était estompé dans ses parages. Un sans-abri dormait pieds nus, bienheureux, devant des immeubles abandonnés qui avaient été reconvertis en parkings sauvages au sous-sol. Les innombrables fils électriques décoraient les ruelles en contrebas où végétation et taudis faisaient office d’avant-plan contrasté avec les buildings aux designs parfois futuristes dans le lointain. Nous ne nous sentions pas en insécurité — jamais nous ne nous sentîmes en insécurité durant notre séjour thaïlandais. Il régnait une tranquillité telle, dans ce quartier aux façades lépreuses où les pièces de linge avaient pour toute garde-robe des fils de fortune tendus entre deux poutres, que j’aurais pu accepter d’y faire ma vie, pourvu que j’y disposasse d’Internet. Ma compagne calma mes ardeurs : il devait faire étouffant dans ces petites bicoques de tôle et de bois.

Une forêt diffère d’un parc en ce que l’écosystème est capable d’y survivre sans la main verte de l’homme : ainsi nous expliquait un panneau, à l’entrée de Benchakitti, que nous ne nous trouvions pas dans un parc, mais dans une forêt. Il n’y régnait guère l’impression oppressante que l’on se fait d’un bois avec ses hauts arbres et un ciel invisible. Tout était bien dégagé et l’on voyait par endroits que l’homme avait aménagé les lieux. Nous avancions sur une passerelle surélevée qui nous permettait de contempler la basse végétation, de petits étangs, des pelouses entretenues.

Peu à peu les cieux se découvraient : nous n’aurions pas droit à la pluie annoncée. La chaleur humide du début de notre promenade devenait brûlante quand les rayons du soleil touchaient la terre.
Plusieurs photographes, ici avec un couple marié, là avec une jeune diplômée, prenaient des clichés souvenirs à divers endroits clés. Aux quatre coins du parc forestier, des gratte-ciel nous contemplaient de leur hauteur — à se demander comment les Bangkokiens avaient fait pour préserver ce vaste pan de nature au fil des ans et de l’expansion démesurée de leur cité, eux qui partout ailleurs avaient construit sur la moindre parcelle disponible. Rien d’exceptionnel ne magnifiait Benchakitti, finalement, si ce n’est son existence même.













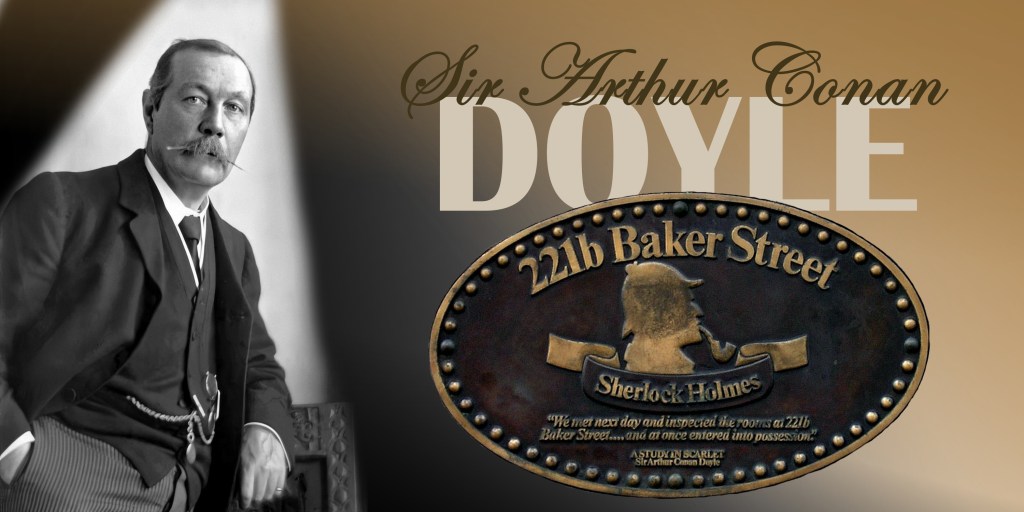






Laisser un commentaire