Partis d’Olvera, vous traversez des collines sableuses et désertiques, parfois tachetées de végétation anarchique, puis vous arrivez à cet endroit où la terre se soulève plus encore, à cet endroit où le sable se transforme en roc, à cet endroit où sans transition le vert lisse et humide prend le pas sur l’ocre et peint avec grâce les courbes qui s’offrent à lui.
Vous apercevez, dans le creux de la vallée, un lac bleu vif aux formes langoureuses et, à son extrémité, en levant les yeux, vous découvrez Zahara de la Sierra.

Au cœur du paysage montagneux, le rocher sur lequel elle se juche n’a rien de banal, au contraire ; son caractère massif et dissymétrique renforce l’impression centrale que lui confère sa position stratégique. Son côté gauche et bombé l’élève doucement mais sûrement jusqu’à des hauteurs qui seraient insoupçonnées si son côté droit ne s’affaissait pas brutalement, vertigineusement dans le vide.
Sur le point culminant du rocher se dresse la Tour de l’Hommage, carrée, massive, pas très haute — reste du château moyenâgeux qui d’antan surveillait le territoire. En contrebas, tout semble tourbillonner autour d’elle. Côté gauche, il y a ces chemins de gravats, pittoresques mais glissants, qui, enroulés sur le flanc de montagne, laissant parfois entrevoir des restes de muraille, relient le sommet au village, côté droit. Celui-ci profite d’une accalmie dans l’abrupte chute pour s’entortiller à son tour autour de la tour. Les petites maisons blanches, les unes à la suite des autres, descendent, tournent, s’enroulent dans ce qui s’apparente à un colimaçon éclatant.
Quoi de plus normal, pour un village qui se fond dans la nature sauvage, qu’une forme animale ? Ici, les rapaces règnent ; ils tournent eux aussi autour du sommet, mais en altitude. Plus bas, leurs proies, lézards et mulots, profitent du terrain escarpé pour s’abriter furtivement dans le creux des rochers. Abeilles, mouches et papillons furètent partout, comme si tout cet espace n’appartenait qu’à leurs petites ailes. Et le soir, aux alentours de vingt heures, quand le soleil se retire petit à petit derrière la montagne lointaine, tous les volatiles qui habitent les arbres du coin participent à une joyeuse chorale de pépiements ; leur chant d’au revoir enveloppe la cité. Durant ces moments magiques, même les chiens se taisent, eux qui pourtant, à longueur de journée, aboient sans relâche au moindre prétexte. Oui, les animaux gardent leurs droits par ici — ce ne sont pas les chats paresseux, les chèvres en transhumance, les lapins peureux et les poissons voltigeurs du lac qui me contrediront.
Oui, ici, la nature est reine, et elle tient à le rappeler. Il n’est pas rare qu’elle envoie son souffle balayer mont et vallée. La tempête, sans pitié, emporte ce qu’elle peut sur son passage. Des branches d’arbre sont arrachées, voltigent dans les airs, dévalent les pentes, sont prises dans les filets d’autres arbres, plus forts, plus résistants. Les feuilles s’envolent et fouettent les obstacles sur leur route. Elles tombent sur les hauteurs du village, là où Éole peut encore s’engouffrer avec impétuosité, et elles dégringolent les ruelles en bande, plus bas, toujours plus bas, jusqu’à ce que, prisonnières du paravent de murs blancs, elles tourbillonnent désespérément sur place, avec peine, colorant les pavés gris de leur voile toujours vert.
Ah ! Les rues de Zahara ! Ne font-elles pas, elles aussi, le charme du village ? Étroites, pavées plutôt que goudronnées, mettant piétons et véhicules sur un pied d’égalité, hébergeant ici un repas familial et là la terrasse d’un restaurant, accueillant les pas et saluts des habitants et voyageurs qui se croisent, dévoilant l’intérieur des petites maisons aux portes grand ouvertes qui les longent, elles symbolisent l’esprit de la cité.














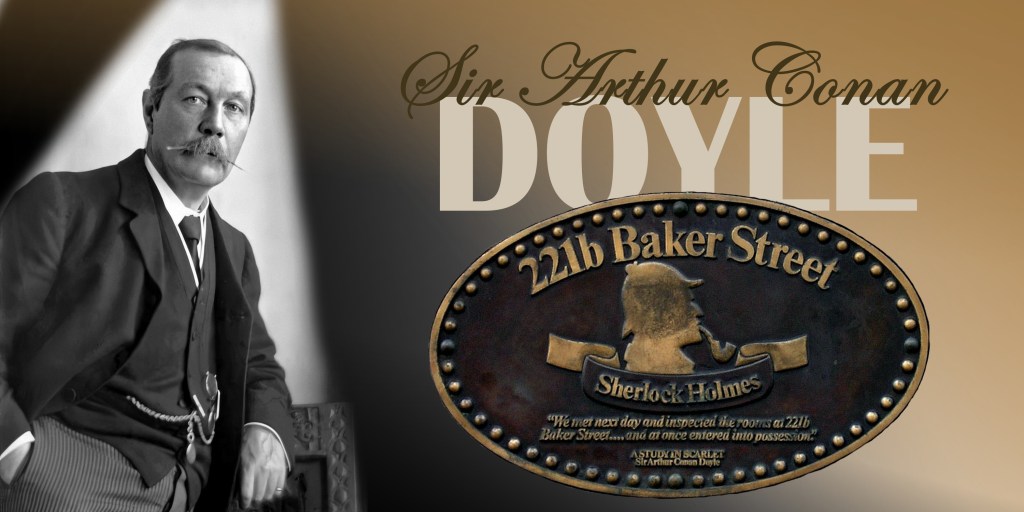






Laisser un commentaire